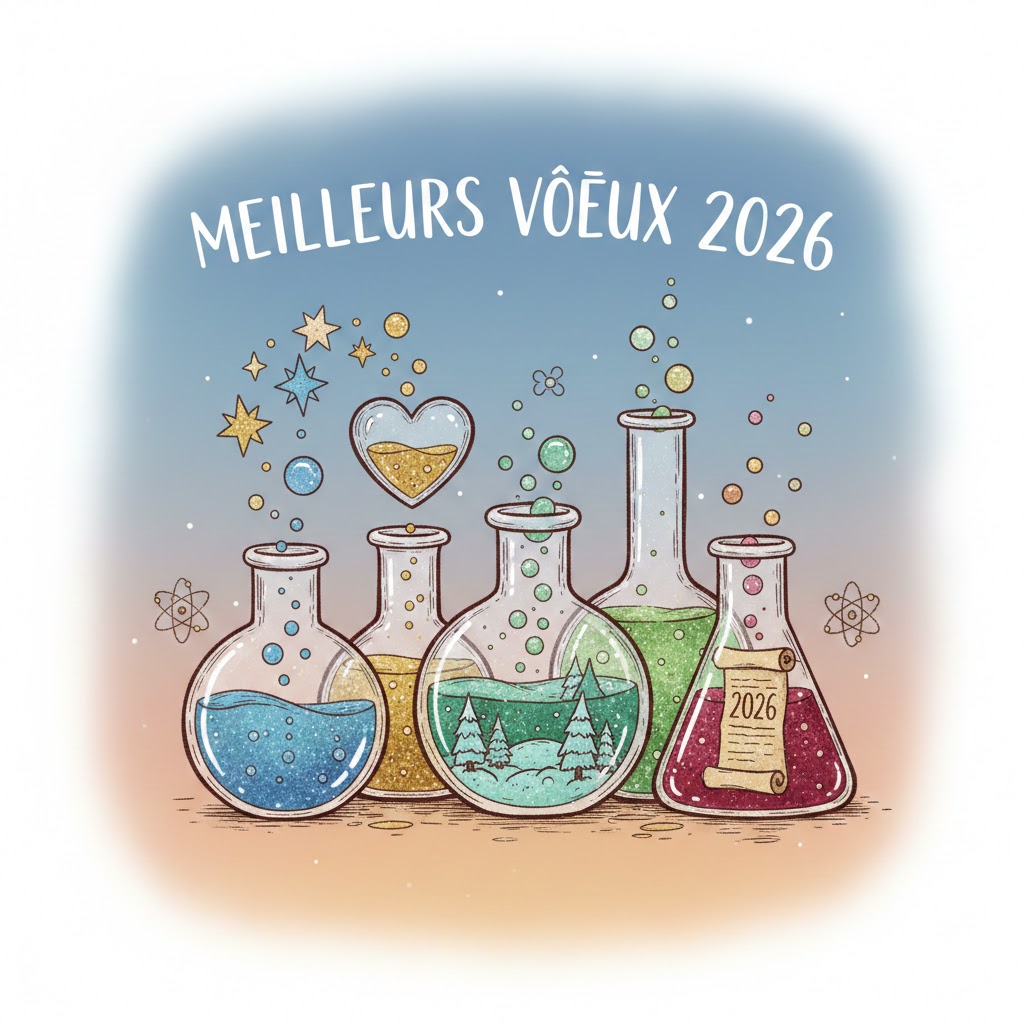2026 : La Toxicologie au cœur des défis de l’humanité
Chers membres de l’ATC, chers amis,
3 ans jour pour après le décès d'André, une nouvelle année commence et en tant que président et vice-président de notre association, nous vous souhaitons avec Nicole, une excellente année 2026. Que ces prochains mois vous apportent la santé, l'épanouissement personnel et, surtout, la réalisation de tous les projets qui vous passionnent, qu'ils soient scientifiques, professionnels ou personnels.
Pour l’ATC, 2026 sera marqué par l’organisation d’un séminaire de 2 jours à Lyon, dans les locaux du CIRC. La participation à ce séminaire sera gratuite pour les membres de l’ATC et ses intervenants. Le sujet de ce séminaire : « Toxicologie, une science toujours d'actualité », abordera plusieurs sujets d’actualité où la toxicologie et la toxico-chimie ont des éclairages importants à apporter.
Vous trouverez ci-dessous le détail de notre programme, qui fait écho à une note manuscrite d’André Picot, que j’ai retrouvé en fouillant dans mon armoire des docs et cours de l’ATC.
Ce texte écrit par André en 1998 est incroyablement moderne et en voici un extrait :
« Tous les chercheurs des Sciences de la Vie doivent s'unir à l'échelle mondiale pour résoudre ces deux grands problèmes qui concernent directement la survie de l'espèce humaine, sans pour autant négliger d'autres problèmes sérieux. Parmi les plus importants, citons ceux qui concernent :
- l'écologie et la protection de l'environnement
- les maladies épidémiologiques et parasitaires
- des pathologies graves n'ayant pas encore de traitement satisfaisant
- atteintes cardio-vasculaires
- maladies dégénératives du système nerveux
- maladies auto-immunes
- sans oublier les problèmes liés au vieillissement
D'un point de vue encore plus général, dans le domaine thérapeutique, la plupart des médicaments disponibles ont jusqu'à présent pour cible moléculaire les protéines (récepteurs membranaires, enzymes, tubuline...). Or depuis quelques années, de nouvelles approches thérapeutiques se développent en agissant directement sur les acides nucléiques (ADN et ARN) en vue de moduler sélectivement l'expression des gènes : il s'agit de la thérapie génique. Les progrès spectaculaires des Sciences de la Vie suscitent beaucoup d'espoir, mais il faut néanmoins rester prudent, le rapport bénéfice/risque devant toujours être évalué, ainsi qu'une prise en considération des problèmes d'éthique. C'est à ce prix que les progrès récents de la Biologie Moléculaire et de la Biochimie seront bien acceptés par une population qu'il faudra sensibiliser de plus en plus aux problèmes de santé et à la protection de l'environnement. »
En 2026, PFAS, nouvelles drogues de synthèse, changement de régime alimentaire vaccination par ARNm sont autant de sujets d’actualité. Alors, plus que jamais, la toxicologie est une science d’avenir et l’ATC poursuit sa mission d’information, de formation et de vulgarisation. Nous espérons vous voir nombreux à Lyon pour honorer cet héritage et construire ensemble les solutions de demain.
Excellente année à toutes et à tous.
Nicole et Frédéric
Le riz est une plante qui accumule naturellement fortement l’arsenic, 10 fois plus que les autres céréales. Le riz pousse dans l’eau qui contient de l’arsenic minéral.
Les Composés Minéraux de l’Arsenic (As) sont des cancérogènes avérés chez l’Homme, sur la base d’études épidémiologiques. Ils sont classés dans Groupe 1 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).
Le rapport de l’EFSA de 2014 sur l’exposition alimentaire aux composés de l’arsenic qui prend en compte la spéciation est très utile pour répondre à cette préoccupation.
Quel type de riz consommer ? Du riz blanc ou du riz complet ?
L’As minéral dans le riz blanc est de l’ordre de 90 µg/kg, dans le riz complet de l’ordre de 150 µg/kg.
La quantité d’arsenic minéral est-elle fonction de la variété ?
IL existe plusieurs variétés de riz : parfumé, basmati, rond, long... On observe une variation de la quantité d’arsenic en fonction de la variété génétique de la plante.
Le riz parfumé et le basmati contiendraient moins d’arsenic que les autres variétés.
La quantité d’arsenic est elle très dépendante du lieu de culture ?
Que le riz provienne d’Asie, d’Europe, des USA… il contiendra toujours de l’arsenic minéral, avec à peu près la même concentration, et elle est élevée.
Le riz de Camargue ne contiendrait pas moins d’arsenic que les autres.
Et le riz bio ? Il aura toujours la même concentration d’arsenic, mais moins de résidus de traitement phytosanitaire.
Quelles sont les différentes présentations du riz en grains à l’achat ?
On trouve différentes couleurs. S’il est brun, noir, rouge, il est complet (avec le son). Le riz complet, quelle que soit sa couleur initiale, s’il est décortiqué, poli… il devient blanc.
Quelles sont les stratégies de cuisson pour diminuer la quantité d’arsenic minéral qui sera ingérée, tout en gardant les nutriments intéressants du riz (Zn, Mg, P, K, Mn) ?
Depuis 15 ans au moins, les chercheurs du domaine de la spéciation analytique ont testé différents modes de cuisson pour diminuer la quantité d’arsenic minéral ingérée.
Une des recettes consiste à laver le riz avant la cuisson dans au moins 3 Volumes d’eau/1Vol. riz. Puis la cuisson se fait dans de grands volumes d’eau bouillante (6 Vol. d’eau/1 Vol. riz) en évitant l’évaporation de l’eau.
Une diminution de la concentration en arsenic minéral dans le riz est observée, de l’ordre de 35 à 45% selon le type de riz.
Il existe une autre proposition de recette, plus récente (2020), visant aussi à garder les nutriments pendant la cuisson tout en éliminant plus de 50% de l’arsenic minéral.
Faire bouillir de l’eau seule (4 Vol. d’eau), puis ajouter le riz (1 Vol. de riz) dans cette eau bouillante. Faire bouillir pendant 5 min. Jeter l’eau de cuisson qui contient de l’arsenic minéral. Ajouter de l’eau fraiche (2 Vol. d’eau/1 Vol. riz de départ). Faire cuire à feu doux avec un couvercle jusqu’à absorption complète de l’eau.
Pourquoi l’arsenic minéral apporté par le riz est-il un sujet de préoccupation actuel ?
Le riz remplace les céréales traditionnelles dans les régimes sans gluten.
Le riz entre dans la composition de préparations alimentaires pour les bébés et jeunes enfants, dans ce cas la concentration en Arsenic doit être < 0,10 mg/kg. Il existe aussi des galettes de riz soufflé (~1 µg As/galette), des feuilles de riz, des gâteaux à base de farine de riz, des crackers pour lesquels la concentration en Arsenic doit être < 0.30 mg/kg (Règlement UE 1881/2006 Modifié en 2015).
Quels choix faire pour diminuer notre consommation d'arsenic minéral ?
A chacun de nous de faire des choix selon nos connaissances et nos souhaits, c’est donc un choix entre bénéfices et risques !
Nicole Proust, Octobre 2025
Bibliographie
EFSA Journal. Dietary exposure to inorganic arsenic in the European population. Scientific Rep 2014;12(3597):1–68. http://online library.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3597/epdf.
Raab A, Baskaran C, Feldmann J, Meharg AA.
Cooking rice in a high water to rice ratio reduces inorganic arsenic content. J Environ Monit 2009;11:41–4.
Spanu A, Daga L, Orlandi AM, Sanna G.
Irrigation techniques in arsenic bioaccumulation in rice (Oryza sativa L.). Environ Sci Technol 2012;46:8333–40.
Banerjee M, Banerjee N, Bhattacharjee P, Mondal D, Lythgoe PR, Martínez M, et al.
High arsenic in rice is associated with elevated genotoxic effects in humans. Scientific Rep 2013;3(2195):1–8.
] Raab A, Feldmann J, Meharg AA.
Levels of arsenic in rice: the effects of cooking, Report C01049, Foods Standard Agency (UK). 2009, p. 1-27. https://www.food.gov.uk/sites/default/files/322-1-599 LEVELS of ARSENIC in RICE - EFFECTS OF COOKING.pdf. https://www.food.gov.uk/sites/default/files/169-1-605 Copy of Arsenic in Rice -Literature review Final Report.pdf.
Fontcuberta M, Calderon J, Villalbí JR, Centrich F, Portana S, Espelt.
A, et al. Total and inorganic arsenic in marketed food and associated health risks for the Catalan (Spain) population. J Agric Food Chem 2011;59:10013–22.
Chen Y, Han Y, Cao Y, Zhu Y, Rathinasabapathi B, Ma LQ.
Arsenic transport in rice and biological solutions to reduce arsenic risk from rice. Front Plant Sci 2017;8:268.
Jackson BP, Taylor VF, Punshon T, Cottingham KL.
Arsenic concentration and speciation in infant formulas and first food. Pure Appl Chem 2012;84:215–23.
Juskelis R, Wanxing Li W, Jenny Nelson J, Jack C. Cappozzo JC.
Arsenic Speciation in Rice Cereals for Infants. J. Agric. Food Chem. 2013, 61 (45):10670–6.
Manoj Menon a, ⁎, Wanrong Dong b , Xumin Chen b , Joseph Hufton a , Edward J. Rhodes
Improved rice cooking approach to maximise arsenic removal while preserving nutrient elements.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143341
Règlement UE 1881/2006 Modifié en 2015 sur les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1006
Proust N. et Picot A.
Toxicologie de l'arsenic et de ses composés : importance de la spéciation. EMC Pathologie Professionnelle et de l’Environnement.
Volume 14 > n◦4 > octobre 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S1877-7856(19)66488-3
https://www.em-consulte.com/article/1325477/toxicologie-de-l-arsenic-et-de-ses-composes-import
M. Menon, W. Dong, X. Chen et al
Approche améliorée de cuisson du riz pour maximiser l'élimination de l'arsenic tout en préservant les éléments nutritifs
Science of the Total Environment 755 (2021) 143341
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143341
Chers collègues, chères amies, chers amis,
Vous pouvez trouver en pièce jointe, le programme du colloque de Lyon 2026
Pour nous joindre Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
ATC Académie :
L’objectif de ces programmes de formation est de vous aider à acquérir des connaissances et des outils en toxicologie / toxicochimie pour vous permettre d’appréhender les risques et de développer une stratégie de prévention adaptée.

Cette acquisition de compétence vous est proposée par un enseignement à distance, en plusieurs séances limitées à 2 heures.
Les premières séances sont des incontournables pour avoir les bases scientifiques. L’autre partie des séances peut être choisie en fonction des cas pratiques qui intéressent les auditeurs.
La programmation des séances est sur le rythme d’une séance hebdomadaire, afin que le cycle complet soit réalisé sur une période d’un peu plus d’un mois. Nos formateurs sont des intervenants/experts de l’ATC.
Ces formations peuvent avoir lieu pour un minimum de 6 personnes et jusqu’à un maximum de 12 auditeurs. Le format en visioconférence permet pour 5 séances de facturer ces cycles ATC Académie 550€ /personne.
Lancement d'ATC académie à la rentrée, 3 cursus de cours à distance seront proposés avec des thématiques cibles :
Nous consulter pour plus d’informations (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
- Selon Confessions of a Supply-Side Liberal, il semblerait qu’il existe une forte relation entre les taux d'obésité et les taux d'anorexie. Par quel dérèglement chimique ou génétique peut-on expliquer cette corrélation ?
L’obésité, l’anorexie et la boulimie sont d’importants facteurs affectant la santé d’une partie croissante de la population, considérés même comme phénomène épidémique. Ces désordres sont liés à de nombreux déterminants comme la disponibilité alimentaire, l’équilibre nutritionnel du régime, l’activité physique, la susceptibilité génétique mais aussi les stress sociaux et environnementaux (expositions aux polluants). Ces désordres métaboliques (incluant le diabète et appelés syndrome métabolique) peuvent augmenter les risques de nombreuses maladies chroniques contribuant ainsi à une diminution de la qualité de vie et de l’espérance de vie.
Les mécanismes qui sous-tendent les altérations du comportement alimentaire sont complexes et multi-étapes avec des aspects génétiques, hormonaux, neurologiques et psychologiques (ou psychiatriques), ce qui ouvre à l’interaction possible de nombreux facteurs. Les signes évidents de ces altérations se traduisent par des variations de poids et de silhouette. La régulation du comportement alimentaire met en jeu, des hormones gastro-intestinales puis des signaux agissent au niveau central sur des structures clés de l'hypothalamus et du tronc cérébral. L'ingestion d'aliments s’accompagne aussi d’un plaisir ressenti appelé « boucle de la récompense » qui permet à l'organisme de se diriger vers des nourritures essentielles au maintien d'une balance énergétique. Intervient dans ce cas un circuit dopaminergique impliquant des récepteurs spécifiques (D 2/3). Lors de dysrégulations du comportement alimentaire on observe des altérations notables dans la régulation des signaux endocrines (leptine, insuline…) et dans la transmission dopaminergique.
- Nous semblons observer une prévalence de l’anorexie chez les adolescents et les jeunes adultes, en particulier les femmes. L’exposition à des produits chimiques lors du développement, peut-elle expliquer ce phénomène ? Les cosmétiques, ont-ils un rôle dans ces perturbations comportementales ?
Les altérations du comportement alimentaire ont évidemment une large part de facteurs psychologiques et donc sont susceptibles de se manifester à des périodes charnières de la vie ou l’individu construit sa relation avec la société et l’environnement qui l’entoure. Evidemment l’adolescence est la période la plus critique, en particulier pour les jeunes filles sensibles aux effets de mode et de références esthétiques. Mais il est aussi difficile d’identifier le « facteur premier ». Pour ce qui concerne les aspects esthétiques (silhouette) le facteur génétique est évidemment déterminant mais il joue aussi dans la susceptibilité. Par exemple les populations issues du Maghreb ont une prédisposition au diabète et au surpoids, qui se manifeste dans les pays d’origine et d’émigration. Dans Ce cas, des changements significatifs de régime alimentaire augmentent les risques d’obésité (exemple avec les afro-américains). Comme la régulation pondérale est fortement lié à des équilibres hormonaux, le développement des connaissances sur les mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens a permis de mieux établir les relations entre la pollution environnementale et le syndrome métabolique. Si on considère les atteintes possibles au métabolisme des lipides on peut se référer aux substances pouvant interagir avec le récepteur PPAR comme les phtalates, les PFAS, les organoétains, ou même des substances naturelles comme la génistéine présente dans le soja. D’autres contaminants interfèrent avec la sécrétion d’insuline comme certains éléments traces (As), mais aussi des POPs (DDT, PCBs) des pesticides comme l’atrazine ou des additifs comme le glutamate. D’autres interactions peuvent se réaliser via les récepteurs au glucocorticoïdes (ex. le BPA). De nombreuses études ont aussi porté sur les fumeurs et on a constaté que le fait de fumer ou le sevrage pouvaient entrainer de fortes variations pondérales. On a aussi ces mêmes réactions avec des médicaments comme les benzodiazépines ou d’autres drogues.
- Il y a-t-il des périodes de la vie où nous sommes plus susceptibles aux produits chimiques dans notre environnement ? S’en protéger diminuera-t-il l’incidence de l’obésité, du diabète et de l’anorexie dans nos sociétés occidentales ?
La période la plus sensibles est à l’évidence la phase d’organogénèse, correspondant à la gestation et à la période post natale (souvent appelée période des 1000 jours). Un bon exemple est donné chez les femmes fumeuses. Dans la fumée de cigarette, il y a aussi les goudrons (HAPs) qui jouent sur le fonctionnement des adipocytes chez le nouveau-né, ce qui entraîne un poids réduit à la naissance (de 200 à 400g) mais un risque de surpoids et d’obésité dans la suite du développement (+ de 10 cigarettes/jour). C’est pour cela que des études de bio-surveillance analysent le sang du cordon et le lait, deux voies d’exposition fœtale et néonatale. De même la malnutrition pendant la gestation à des conséquences graves sur le métabolisme et le comportement du futur enfant. Des déséquilibres alimentaires au cours de l’enfance et de l’adolescence peuvent être un facteur d’obésité. Pour conclure on peut dire que les causes d’altérations du comportement alimentaire sont multiples, mal connues et sont l’objet d’intenses recherches. Par exemple avec mon équipe de nutrition et toxicologie de l’Université St Joseph de Beyrouth, nous avons cherché à discriminer sur une cohorte de 250 personnes les paramètres pouvant induire le syndrome métabolique. Entre contamination, pratique d’un sport, données sociologiques et alimentation, c’est le facteur « changement de profil alimentaire » qui apparait comme le plus déterminant.
Glossaire :
PFAS : composés polyfluoroalkylés, PCB : Polychlorobiphényles, HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques, POPs : Polluants organiques persistants, BPA : Bisphénol A, PPAR : Récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes (peroxisome proliferator-activated receptor, PPAR) appartient à la superfamille des récepteurs nucléaires agissant comme facteur de transcription des gènes impliqués notamment dans le métabolisme des lipides et l'adipogenèse.
Retrouvez le texte de Jean-François NARBONNE directement sur le site d'ATLANTICO
Le dernier avis du Professeur Narbonne, sur les risques de l'oxyde d'éthylène présent dans les aliments est disponible ici :
Aliments contaminés par l’EO : Quelle est la réalité des risques ?
Nouveau Module : formation en INTRA
4) AIR INTÉRIEUR
Public cible : Médecins (du travail, généralistes...) Hygienistes, IPRP ... et toute personne curieuse.
Durée : 2,5 jours (soit 17 heures)
Prérequis : néant
Prix : 5600 € ttc (pour 12 personnes maxi soit 470€/pers et 5 personnes mini)
Lieu : - sur site pour les entreprises qui réunissent leurs collaborateurs en INTRA,
- ou dans les locaux de l'AFBB : 9 bis rie Gérando, 75009 à Paris,
- ou en visio-conférence selon les obligations de l'actualité
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT :
Jennifer OSES
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
07 85 15 72 51
MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Téléchargez le bulletin de pré-inscription
Si, malgré nos précautions, vous apercevez une image, une photo, un schéma... qui ne vous semble pas libre de droits, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler afin que nous puissions corriger cette erreur involontaire.
L’ATC est une association d’intérêt public, gérée uniquement par des bénévoles.
L'ATC ne tire aucun bénéfice de ses publications. Elle s’inscrit dans une ligne éditoriale scientifique de mise à disposition d'informations dans les domaines de la toxicologie, de la toxicochimie et de l'écotoxicologie.
Sous-catégories
AVERTISSEMENT
Si, malgré nos précautions, vous apercevez une image, une photo, un schéma... qui ne vous semble pas libre de droits, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler afin que nous puissions corriger cette erreur involontaire.
L’ATC est une association d’intérêt public, gérée uniquement par des bénévoles.
L'ATC ne tire aucun bénéfice de ses publications. Elle s’inscrit dans une ligne éditoriale scientifique de mise à disposition d'informations dans les domaines de la toxicologie, de la toxicochimie et de l'écotoxicologie.